« Le fascisme se méfiait du football »
Interview L'historien Paul Dietschy explique comment les régimes totalitaires, à l'image du fascisme italien, ont mis le football au service de leur cause.
Paul Dietschy est docteur en histoire contemporaine, maître de conférences à l'université de Franche-Comté et à l'Institut d'études politiques de Paris. Spécialiste de l'histoire du football, il a publié Histoire du football (Perrin).
Comment le régime fasciste a-t-il utilisé le sport?
Dans ce domaine, le projet fasciste comporte deux volets: créer un homme nouveau et créer une nation sportive. Le premier projet vise à développer les sports de base: l'athlétisme, la natation. Les fédérations sont mises sous tutelle par le CONI, le comité olympique national. On construit des camps sportifs, des terrains de sport avec une piste d'athlétisme, de football, de saut. Le but est militaire faire des soldats pour les garçons, et hygiéniste pour les filles. En ce qui concerne le second projet, le régime compte utiliser la puissance symbolique du sport sur la scène internationale. Il veut rompre avec "l'Italieta" la petite Italie libérale qui n'avait fait que peu de choses pour le sport.
Quelle place prend le football dans ce projet?
Le football ne s'insère pas immédiatement dans la politique fasciste. Le foot n'a pas besoin du fascisme car il prend seul son essor dans les années 1920. Et le fascisme s'en méfie, car il est suspect pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il incarne le professionnalisme rampant dont la dénonciation considère les joueurs comme des mercenaires. De plus, il y a eu une affaire de corruption en 1927, impliquant des dirigeants du Torino qui auraient acheté un joueur de la Juve. Cela ne correspond pas à l'éthique de sacrifice. Enfin, le calcio est le théâtre de violences de la part de supporters.
« Le foot s'impose malgré le régime »
Le régime ne souhaite pas faire la promotion du football?
À la fin des années 1920, le football est d'autant plus suspect que le secrétaire du parti fasciste est Augusto Turati, un ancien escrimeur, qui veut un sport amateur, un sport de masse. Il crée d'ailleurs la "volata", une discipline de synthèse, un sport de loisir qui se joue à huit. Il essaye de développer le rugby, notamment par l'intermédiaire des groupes universitaires fascistes (GUF). Au début des années 1930, on va construire de grands stades. Pour les municipalités, va se poser le problème de leur exploitation: le foot permet de les remplir. Mais malgré les succès victoires aux Coupes du monde 1934 et 1938 le foot suscite des suspicions de la part du pouvoir. Les salaires font débat, par exemple. Le foot s'impose malgré le régime, en quelque sorte.
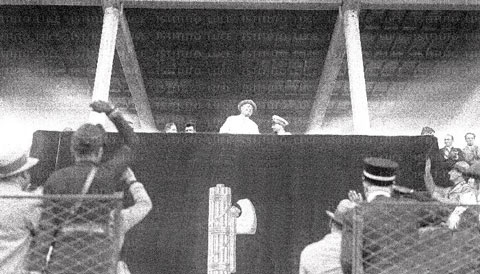
Benito Mussolini assiste à la finale du championnat 1929 Bologne-Torino au Stadio del Partito de Rome.
Les Jeux olympiques de Berlin arrivent dans un contexte particulier: l'équipe nationale est championne du monde, l'armée vient de conquérir l'Ethiopie suscitant la désapprobation de la Société des nations qui décrète un embargo économique. Quels sont les enjeux de la compétition?
1936, c'est le régime triomphant. Le pays a passé outre les sanctions de la SDN, Addis-Abeba vient d'être prise. Le régime est à son sommet jusqu'à l'automne 1936 et l'intervention dans la guerre d'Espagne.
Sport et totalitarisme sont souvent liés. Comment cela s'est-il passé dans l'Allemagne nazie?
En Allemagne, il n'y a pas de réticence à fabriquer une nation sportive, car il y a l'héritage de Weimar, pour lequel le sport était un moyen de pallier l'interdiction du service militaire. Donc, sous le national-socialisme, on continue avec par exemple neuf heures hebdomadaires de sport à l'école. Le sport est nazifié: on valorise l'affrontement, la puissance. Cela a d'ailleurs des conséquences sur le jeu: jusqu'en 1934, la Mannschaft joue comme les pays d'Europe centrale avec des passes courtes, un jeu technique. Ensuite, leur style devient plus physique, ce qui contribuera d'ailleurs à leur succès en 1954.
« Le football n'est pas le sport soviétique par excellence »
Et en URSS?
Pour l'Union soviétique, le sport est également un enjeu important. Il y a des débats dès les années 1920 en faveur d'un sport hygiéniste, prolétarien. Le régime refuse de participer aux épreuves internationales dans les années 1930. On développe l'éducation physique de masse, la natation, l'athlétisme, le tir, le ski... afin de former les futurs soldats. Le football est regardé avec suspicion, mais il est toléré. Ce n'est pas le sport soviétique par excellence.
Comment le régime de Vichy aborde-t-il la question en France?
La France et l'Etat français essayent dès 1940 de moraliser le sport et, par exemple, de supprimer le professionnalisme. Borotra veut préparer la revanche par le sport, qui doit se développer dans un esprit patriotique. Cyclisme et football restent tout de même les sports les plus prisés par le public. Vichy est contraint au spectacle de masse.
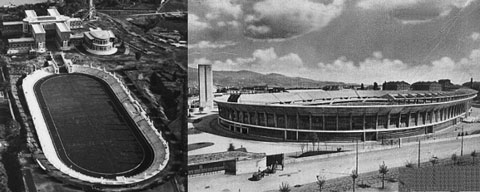
Stadio dei Marmi à Rome et Stadio Mussolini (futur Stadio Comunale) à Turin.
Revenons à l'Italie. Le football transalpin, après la guerre et jusqu'à nos jours, a-t-il bénéficié de l'héritage de la politique sportive fasciste?
Pour partie oui. Par exemple, jusqu'à la Coupe du monde 1990, certains stades sont ceux construits par Mussolini. De même, le championnat de Série A, qui a prospéré sous son règne, est peut-être la plus solide des institutions italiennes. Aussi, il reprend dès 1945 avec les mêmes schémas: les duels Inter-Juve, l'attention de la presse
N'y a-t-il pas des ruptures?
Si. Sous le fascisme, le sport préféré est le cyclisme. Mais dans les années 1950-1960, l'urbanisation entraîne la prédominance du football, dans lequel les Trente glorieuses amènent les mécènes. Jusqu'à la fin des années 1950, le foot italien n'est pas meilleur que son homologue français. Il connaît vingt ans de vaches maigres. C'est dans les années 1960 que l'Inter, l'AC Milan, la sélection au championnat d'Europe 68, gagnent. De nombreuses spécificités du football italien tel qu'on le connaît proviennent du fascisme. Mais c'est le dynamisme des grands clubs qui l'a fait renaître.
Lire aussi "Vaincre à Berlin", sur la victoire de l'équipe italienne aux JO 1936.
